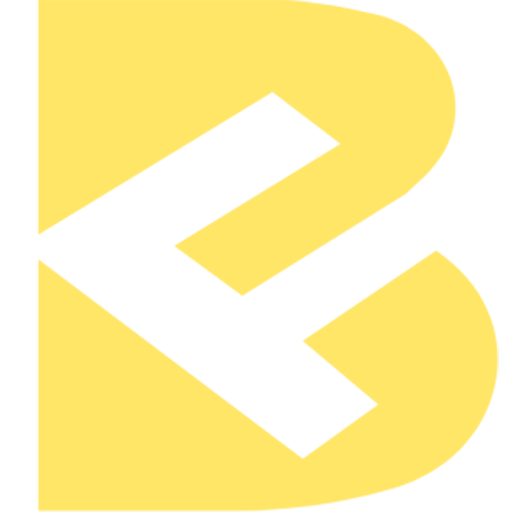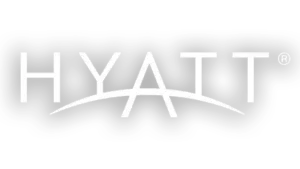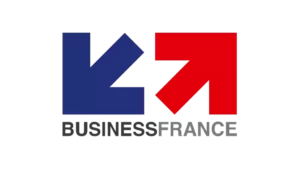Symbole de la cupidité du monde financier, la banque Goldman Sachs a joui d’une influence sans précédent dans les sphères décisionnelles pour faire plier les grands de ce monde. Retour en compagnie du réalisateur, Jérôme Fritel sur le succès de ce thriller financier, co-écrit avec le journaliste Marc Roche. Les enseignements de l’histoire de Goldman Sachs nous rappellent qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre au pas la finance mondiale. Citoyens restez vigilants !
Expliquez-nous ce qui vous a poussé à faire ce documentaire ?
Il s’agissait de donner quelques clés pour comprendre une partie de la crise financière. Je trouvais important qu’on essaye de comprendre ce qui s’était passé, car on vit aujourd’hui dans les conséquences de la crise. Les gens l’ont bien reçu, car il y a une soif de trouver des explications à ce qui s’est passé et le succès a dépassé toutes nos espérances. On a bossé dessus pendant deux ans et le fait de voir que les gens sont réceptifs, c’est toujours agréable.
Avez-vous eu des retours de la part de Goldman Sachs après la diffusion de ce reportage ?
On n’a eu aucun retour de Goldman Sachs, ni officiel, ni officieux. Ce n’est pas étonnant parce qu’il a mis un point d’honneur à ne jamais réagir aux attaques. Surtout aux États-Unis où les critiques ont été les plus virulentes. Ici, j’ai été mis en contact avec leur cabinet de relations publiques français. J’ai failli les rencontrer, mais cela ne s’est pas fait. Et depuis la diffusion du documentaire, rien, aucune réaction.

Vous les avez rencontrés un peu avant donc ?
Oui. J’avais rencontré le cabinet de relations publiques un an et demi avant la diffusion. On avait prévu au départ que c’était mieux d’avoir Goldman Sachs pour répondre aux multiples critiques qu’on pouvait leur faire. On était dans un point de vue très journalistique. Marc Roche avait été invité à New York. On a envoyé des questions, ils ont tourné autour. Il y a eu un retour par le cabinet de relations publiques français concernant nos questions. On pensait que ça allait se mettre en place et au dernier moment ils ont préféré ne pas intervenir. Ce qui peut laisser paraître qu’on est unilatéral, tendancieux, mais ce n’est pas de notre fait. Quand un acteur comme Goldman Sachs refuse de communiquer, il laisse les critiques ouvertes. C’est assez révélateur du comportement de cette institution qui considère qu’elle n‘a pas d’explication à donner ou de compte à rendre. Que ce soit au niveau de la justice ou de l’opinion publique.
Après cette première expérience, comptez-vous faire d’autres reportages sur la finance ou sur d’autres sujets économiques ?
J’ai le sentiment que ce documentaire appelle à un prolongement. Je travaille dessus mais je ne l’ai pas encore trouvé. C’est un double travail : de vulgarisation, mais celui-ci peut passer si vous avez une histoire ou un fil dramatique. Je n’ai pas envie de faire un dossier. Il faut donc mêler le fil dramatique (le récit), l’explication et la vulgarisation (décryptage). Je sais sur quoi ce prolongement portera mais c’est encore en gestation. Sinon je travaille sur autre chose. J’ai été grand reporter, j’ai couvert tous les conflits. J’ai une vision globale internationale, pas du tout franco-française des problèmes. Le prochain porte sur le retrait des troupes françaises en Afghanistan.
On peut reprocher à ce documentaire de se concentrer uniquement sur Goldman Sachs. Or, on sait que cet acteur important n’est pas le seul à avoir sa part de responsabilités dans la crise. Pourquoi ce choix ?
Il est vrai que le documentaire se concentre uniquement sur Goldman Sachs. C’est un personnage important, pas le seul évidemment. Mais comme je vous l’ai dit, si vous voulez raconter une histoire, il faut se concentrer sur un personnage. Goldman Sachs, c’est un symbole. Alors du coup on fabrique un méchant un peu facile comme si tous les problèmes c’était cette banque. Or on sait bien, par exemple, que JPMorgan a joué de la même manière. Par contre, là où cette institution sort du lot, c’est justement en ce qui concerne son rôle auprès de la classe politique. Je ne suis pas sûr que toutes les banques aient dans leur ADN cette influence sur la chose publique. Ils ont établi des ponts très solides avec les hommes politiques américains, européens, toutes couleurs confondues. Cette banque est au confluent des affaires, de la vie publique. On ne peut pas dire que BNP ou la Société Générale n’ont pas d’influence équivalente en France. Après, comme m’avait dit un important banquier d’affaire à Paris, « Goldman Sachs, c’est comme pour un joueur de foot le Real de Madrid. » Nous avons donc choisi d’enquêter sur le Real de Madrid de la finance.
On sait également que ces dérives ne se font pas toutes seules. Il y a derrière des institutions, des cadres juridiques qui ont été votés et acceptés par les hommes politiques. Les États sont d’une certaine manière complices de cela. Ne serait- il pas intéressant d’expliquer la collusion existant entre banquiers, politiques et économistes ? Est-ce que c’est dans votre futur projet ?
En ce qui concerne l’environnement, il faut en effet le contexte de dérégulation pour voir acquérir cette influence. On l’aborde mais on ne peut pas tout dire en 90 minutes. Dans le documentaire Inside Job, il y a cette volonté de traiter le problème de façon globale. C’est extrêmement dense, car il y a cette tentation de vouloir tout expliquer. Le risque, c’est que les gens ne comprennent plus rien. Alors nous avons fait le choix d’aller moins loin dans l’explication pour que les gens ne décrochent pas. On a voulu rendre accessible au grand public, pas une fois je ne cite CDS par exemple. Le devoir d’explication doit se faire au niveau du grand public qui n’est pas au fait des pratiques financières.
Le problème de la finance c’est de dire « c’est trop compliqué pour vous, laissez-nous faire. » Nous on estime que ce n’est pas trop compliqué, laissez nous vous expliquer. Ce qui est intéressant c’est que le livre de Marc Roche, qui a été à l’origine de ce projet, a eu un franc succès chez les lectrices. Ce type de document, c’est plutôt électorat masculin à 98% habituellement. Aujourd’hui face à cette crise qui rentre dans la vie quotidienne des gens, les femmes veulent savoir comment ça se passe. Ce sont des actrices économiques. Parfois ce sont même elles qui gèrent le porte-monnaie de la maison. C’était à ces gens-là qu’on a pensé en faisant ce film. Comment vous expliquer une grande histoire qui se passe sous vos yeux, a priori trop compliquée ? Nous, on tente de le faire.
Il y a beaucoup de subtilités et on n’a pas pu tout dire, j’accepte cette critique car ça faisait partie de notre démarche de rendre le documentaire accessible. Sur la dérégulation, on constate qu’elle s’est surtout effectuée sous des gouvernements de gauche. La finance est née de cette dérégulation Blair, Schröder, Prodi, Bérégovoy, Jospin, DSK, Fabius… ce sont eux qui ont libéralisé les marchés financiers. Aux États-Unis, c’est sous Clinton avec Rubin, ancien PDG de Goldman Sachs, qui devient le chantre de la dérégulation financière. Une fois que vous avez ouvert la boîte de pandore, le diable s’échappe et c’est difficile de le remettre dedans. J’ai encore lu il n’y a pas longtemps que les transactions qui échappent à toutes régulations, c’est 50 000 milliards d’euros sur un an. Tout est emmagasiné dans des paradis fiscaux européens dont on tolère l’existence.
Comment expliquer que la gauche en ait fait tellement en faveur de la dérégulation financière ?
La gauche est fascinée par les marchés. Elle va souvent plus loin que la droite. À croire que comme elle n’a pas assez de légitimité, elle doit en faire plus. C’est psychologique. Regardez Bérégovoy par exemple. C’est lui qui a ouvert la dette française aux acteurs étrangers.
La classe politique n’a pas joué son rôle de contre-pouvoir. Soit par ignorance, soit par complaisance, soit par fascination pour l’argent.
La complicité existe également dans le cas où le secteur privé finance les Etats. C’est un peu la carotte agitée par les banques pour qui il s’agissait de dire : “sauvez les banques sinon on ne pourra pas sauver les États”.
Oui, ils se tiennent tous par la barbichette. Après, les États étaient déjà endettés avant la crise.
Mais je remarque que dans ce monde de la finance, il y a une omerta qui est insupportable. Ces gens-là, en période de prospérité, gagnent énormément d’argent avec une utilité à la société que je questionne. Et puis quand ça va mal, ce sont les premiers à se ruer vers les États pour se faire renflouer. Il y a un manque de cohérence et de responsabilité évident. Surtout, il y a eu une impunité totale. C’est incroyable qu’il n’y ait pas eu un seul banquier condamné par la justice, à part des dérives individuelles comme Kerviel, Madoff. Ces banques préfèrent payer 500 000 dollars d’amende, qui correspond à 15 jours de bénéfices que de changer leurs pratiques. Personne n’est allé en prison ou n’a été viré… Je trouve ça indécent, indécent.
Il y a tout de même eu le cas Fabrice Tour alias Fabulous Fab, que vous citez dans le reportage. Est-ce que c’est équivalent à la situation d’un Jérôme Kerviel en France ?
Je pense que ce sont deux personnes qui n’ont rien à voir. Dans le cas de Kerviel on est en face d’une dérive individuelle au niveau d’un système qui manquait de contre-pouvoir dans les processus de vérification. C’est quelqu’un qui a pété un câble dans un environnement qui poussait à perdre le sens des réalités.
Tour, lui, n’a fait aucune dérive individuelle. Il est dans une équipe dont le but du jeu est de fourguer le plus de produits dérivés pourris. Alors, autant le premier se met à la marge d’un système, se cache de ses chefs, fait des faux pour ses positions, autant Fabrice Tour, lui, n’en a fait aucun. Il est l’un des meilleurs soldats de la banque. Il fallait un bouc émissaire, ils l’ont donné en pâture aux gendarmes de la bourse américaine pour éteindre le conflit contre Goldman Sachs. C’était un jeune français qui était un peu arrogant dans ses mails privés. C’est quand même eux qui lui ont fait traduire sa correspondance privé en anglais. Les gens que j’ai rencontré me disent que c’est incroyable la manière dont ils l’ont jeté dans la fosse au lion. Je ne pense pas qu’il ait fait plus que les autres. Goldman Sachs est comme un monstre froid. Aujourd’hui c’est pourtant la seule personne de ce monde financier à avoir été poursuivie. C’était un cadre moyen, son supérieur n’a pas du tout été inquiété.
En 2011, Goldman Sachs c’est 2,5 milliards de bénéfices nets, alors que par exemple Total c’est 12 milliards. Par conséquent le poids de cette banque dans l’économie mondiale n’est pas aussi important que d’autres grandes firmes multinationales. En quoi Goldman Sachs va plus loin que les autres ?
Dans la mentalité anglo-saxonnne on pense qu’on doit défendre ses positions auprès du pouvoir. Là où la finance va plus loin, c’est qu’elle a réussi à déplacer la frontière de la loi. Ils ont tellement bien travaillé auprès des législateurs pour que tout ce qu’ils fassent après ne tombe plus sous le coup de la loi. Le pire dans ce qui s’est passé, c’est que le crime était légal. C’est un trader de Wall Street qui m’a dit ça. Goldman Sachs n’a jamais dépassé les limites de la légalité. C’est ce qui est terrible. Imaginez que vous êtes dans l’industrie automobile : vous demandez à vos ingénieurs d’utiliser toute leur intelligence pour fabriquer la voiture la plus pourrie, avec des freins pourris, une direction faussée, des roues crevées. Vous la commercialisez. La voiture se plante, au premier virage, forcément vous tombez sous le coup de la loi. Dans la finance vous fabriquez les produits les plus risqués et certains sont spécialement créés pour se crasher. Ce n’est pas illégal. C’est tout de même un formidable tour de passe-passe. Ils sont allé vraiment très loin. Dans la finance c’est l’acheteur qui doit faire attention. Le vendeur n’est jamais responsable même s’il vend de la merde. C’est complètement différent des autres industries où il y aurait aussi une forte réaction des consommateurs.
Vous savez que votre reportage peut alimenter les analyses conspirationnistes ?
Avec Marc, nous n’avons pas du tout une visée conspirationniste des choses. Dans le travail qu’on a initié ensemble on voulait deux choses : que ce soit accessible à tout le monde, en en faisant un thriller financier. On ne voulait pas tomber dans le truc conspirationniste qu’on voit beaucoup sur internet en disant qu’il y a un grand complot financier mondial. C’est très séduisant mais je n’y crois pas du tout.
Que pensez-vous des rencontres du Bilderberg dans ce cas ?
Que des gens puissants se réunissent et essayent de définir des positions qui soient le plus à leurs avantages. Après je demande à voir si le gouvernement mondial du foot, la FIFA, est très transparent. Dans le cas de la finance, il ne s’agit pas du tout d’une mafia. Ce sont des entreprises cotées en bourse. Par contre, ce sont des multinationales, c’est à dire des entreprises qui jouent au-delà des frontières et qui ont des responsabilités envers la société en général. Je ne crois pas que le monde de la finance a pris conscience de ses responsabilités. Aujourd’hui je ne suis pas sûr que les mentalités aient évolués. Je pense que quand on bosse dans ce milieu, la mentalité c’est de gagner de l’argent quel qu’en soit le prix.
Que pensez-vous du traitement médiatique de la crise ? Je parle des économistes, ceux qu’on entend souvent dans les médias, et qui sont également présents dans les conseils d’administration des grands groupes financiers. On peut leur reprocher de ne pas aller au bout des choses, et ils expliquent qu’il ne faut pas trop fustiger la finance. Ceux qui défendent ce point de vue sont très bons, ont l’air très sérieux et arrivent à influencer les opinions. Votre avis sur la question ?
Toute cette influence a été encore une fois très bien montrée dans Inside Job, il y a une communauté de pensée, d’économistes, de financiers, les uns finançant les autres. Après il y a aussi des voix critiques.
Le charme et le problème de l’économie, c’est que tout le monde peut dire ce qu’il veut. Ce n’est pas une science exacte, ce n’est pas un problème de maths avec une solution exacte. C’est un peu la foire aux opinions. Les banques, elles, préfèrent initier leurs propres économistes, comme ça, leur bonne parole est répercutée. En face il y a des économistes de gauche ou d’extrême gauche mais je trouve qu’il n’en sort pas grand-chose. On est beaucoup dans la théorie. Il me semble qu’il y a un consensus sur le fait que la finance doit retravailler au service de l’économie réelle dont elle s’était totalement déconnectée. Il y a un consensus idéologique pour le faire mais tout le monde n’est pas d’accord sur les moyens à appliquer.
Il manque peut-être du courage politique, non ?
Oui mais en même temps il y a des États endettés, qui, d’une main ont besoin de ces contrôleurs financiers incontrôlables et de l’autre main, ils voudraient bien les réguler. Tout cela devient très compliqué. On peut agir au niveau de l’Europe, mais encore faudrait-il insister sur l’influence de la Grande Bretagne sur la non régulation financière. C’est leur richesse dorénavant puisqu’il n’y a plus d’industrie. On n’avance pas sur ce sujet car les britanniques opèrent un lobby intensif à Bruxelles, comme sur la taxe financière par exemple. Ils ont une vision utilitaire de l’Europe.
Même la séparation des activités bancaires entre les activités de dépôts et de spéculation ne suffit pas. Goldman Sachs n’était pas une banque de dépôts. Les banques universelles on les a surtout en France. Je pense de toute façon que c’est une planète anglo-saxonne. Les règles ont été édictées par les anglo-saxons, la dérégulation aussi. S’il devait y avoir une re-régulation, cela viendra de Wall Street ou de la City.
Le mode de management de Goldman Sachs, est un peu à l’image de la culture d’entreprise à l’anglo-saxonne, non ?
Totalement, on prend des jeunes brillants, diplômés, malléables. On les met dans un moule et puis on en fait des parfaits soldats. On les appelle les “moines banquiers”. Ils bossent 20h/24 et au bout de 15 ans on les remplace par des gens plus jeunes. En même temps ils ne sont pas ingrats, ils en ont fait des millionnaires. Après ils peuvent rentrer dans des administrations publiques, des institutions internationales. Il y a surement d’autres entreprises qui fonctionnent comme cela, mais je pense que c’est encore plus poussé chez Goldman Sachs. Ils ont une certaine arrogance, une culture du secret, ce sont les seigneurs de Wall Street. Le pouvoir de l’argent est incroyable, il a toujours fasciné.
Il y a, dans le reportage, une anecdote assez surprenante pendant les attentats du 11 septembre. Une salariée, Noémie Prince, nous explique que son patron lui demandait de continuer à spéculer alors que le premier avion s’était déjà écrasé. Pouvez-vous nous expliquez ce passage ?
Elle nous décrit quelque chose entre les deux avions. Au début, personne ne sait s’il s’agit d‘un accident ou d’un attentat. Il s’écoule 20 minutes environ entre les deux avions. Ils sont aux premières loges dans la tour Goldman Sachs. Ils se disent que forcément cela va avoir des répercussions sur le prix du kérosène, de l’assurance etc… Donc ils continuent à jouer. Vous imaginez, une tornade, je joue ! Un attentat, je joue ! Ils ne se soucient même plus du collectif. Ils sont comme des robots. Formatés pour profiter de tout ce qui peut se passer pour spéculer. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c’est de savoir combien ils vont pouvoir gagner sur ce coup-là pour augmenter leurs bonus. On est dans un monde qui vit en vase clos. Ils ne se reconnaissent qu’entre eux d’ailleurs.
À un autre moment dans le reportage, vous citez, sans le dire, la complicité des agences de notation qui ont mis des triple A à des produits toxiques. Pouvez-vous expliciter ce point ?
Ce que je trouve étonnant dans le principe des agences de notation, c’est que le client paye l’arbitre. Imaginez si dans un sport quelconque, les joueurs payent l’arbitre ! Ce serait curieux tout de même. Dans le cas des agences de notation, on est en plus dans une situation d’oligopole avec seulement trois agences sur le marché. On a donc un client comme Goldman Sachs, qui représente un volume de transaction phénoménal. Est-ce que vous pouvez prendre le risque de vous fâcher avec le principal client qui vous fait bouffer ? Je ne crois pas. Goldman Sachs présente un produit en disant : « nos meilleurs spécialistes ont fait des projections, c’est parfait ! » L’agence de notation dit « Ok ça a l’air bien. »
Il ne faut pas oublier une chose non plus. Les agences de notation ne recrutent pas les meilleurs mais plutôt les derniers de la classe. Tous les types rêvent donc de bosser pour Goldman Sachs car ils ne sont pas aussi brillants que leurs clients. Dans ce cas, est-ce que les agences ont les moyens de dire qu’en fait les produits sont risqués ou pas ? Le système a été fait pour que les agences de notation notent aveuglément. Pour le coup, on est dans la réglementation. Est-ce que c’est au client de payer l’agence de notation ? Je pense que cela est de nature à fausser le système. Alors des propositions ont été faites à Bruxelles pour que ce soit plus étanche entre l’agence de notation et les institutions. À l’origine les agences ne sont pas des arbitres. Elles sont là pour évaluer sans pour autant être neutres. On en a fait quelque chose qu’elles ne devaient pas être. Au départ, elles donnent seulement un avis, vous n’êtes donc pas obligé de suivre cet avis. Après, dans les fonds de pension, les Conseils d’administration voulaient seulement du triple A, donc on leur a octroyé un pouvoir qu’elles n’avaient pas initialement. C’est la règlementation qui est défaillante.
Vers la fin du reportage vous vous attardez sur le cas de Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs et nouveau président de la BCE. Il y a notamment cette interview de Jean Claude Trichet où vous lui posez une question sous entendant une collusion entre Mario Draghi et Goldman Sachs. Il refuse d’y répondre. Quelles ont été vos impressions face à cette réaction ?
Il est évident que Jean-Claude Trichet n’a pas vraiment apprécié qu’on lui pose cette question. Pour tout vous dire, on a été très surpris avec Marc. Le rendez-vous avait été pris par écrit et il était bien indiqué que c’était dans le cadre de notre documentaire sur Goldman Sachs. La réponse a été positive. Les choses étaient assez claires dès le départ. D‘ailleurs aucun intervenant n’a été piégé. Pour Jean Claude Trichet, on avait mis trois heures à tout installer et cinq minutes avant l’interview, il nous explique : « je ne dirai pas un mot sur Goldman Sachs. » Lorsque l’interview démarre, il nous fait un petit cours d’économie sur sa vision de la crise financière etc… C’est intéressant, mais on est très éloigné du propos du documentaire. Au bout d’un moment, on tente une question sur le sujet. Et là, ce personnage qui a pourtant l’habitude des conférences de presse, se braque. Même pas un seul commentaire, alors qu’on aurait cru à une réponse langue de bois mais non rien. Ils nous ordonnent de couper la caméra. Là, il réfléchit. On pensait à ce moment-là que peut-être il allait nous dire quelque chose d‘intéressant. Mais non, il nous répond sèchement, « on va faire comme si vous ne m’aviez pas posé la question. » En 25 ans de carrière, on ne m’a jamais répondu comme ça ! Je trouve ça très étonnant.
Comment l’interpréter à votre avis ?
J’imagine qu’il était gêné car je ne pense pas que les personnes qui ont nommé Draghi à la tête de la BCE se fussent rendues compte que son passage chez GS pouvait choquer les gens, voir qu’on pouvait y déceler une collusion directe. On peut en effet se poser la question. Est-ce que quelqu’un, dont le métier était de refourguer des produits financiers aux États, et qui s’était fait une spécialité de produits financiers sophistiqués, voir risqués, doit-il être le gardien du temple ? Cela pose des questions de positionnement.
Dans le monde des hauts fonctionnaires internationaux, qui passent leur temps à faire des allers-retours entre le privé et le public, cela ne pose aucun problème. Trichet est quelqu’un qui n’a jamais travaillé pour le privé. Je lui ai demandé s’il voulait travailler dans le privé. Il n’a pas répondu. Sa réaction est difficile à comprendre. Je pense vraiment qu’il est mal à l’aise car la décision lui appartient aussi. Il doit la co-assumer. Après, cela ne veut pas dire pour autant que Draghi fait mal son boulot. Mais le fait que tous les gens autour de la table pensent tous la même chose, soient passé par les mêmes moules, ou aient travaillées dans les mêmes banques, pose des questions en termes de débat et de diversité des approches. C’est un vrai problème d’ordre démocratique. Toutes les opinions ne sont pas défendues de la même manière. Il y a une asymétrie de position. Sans pour autant dire que Draghi est un agent caché de Goldman Sachs, c’est juste curieux de prendre comme pompiers les hommes qui étaient pyromanes.
Souvent, on oublie de signaler que la science économique, telle qu’elle est reconnue et acceptée dans le monde, a sacralisé des économistes capables d’établir des modèles de prévisions, notamment autour des valeurs boursières.
Oui, comme si on allait domestiquer le risque… Quelle vanité ! Je pense que l’économie a besoin d’un peu d’humilité car 9 fois sur 10 les prévisions sont fausses. On modélise tout jusqu’à ce que ça ne marche pas. Il n’y a aucun mea culpa de la part des économistes, ni des financiers, ni de la classe politique qui a dérégulé. Je pense que c’est ce qui passe très mal auprès de l’opinion publique. Pas d’excuses et une impunité totale.
Avec tout ça, vous avez le terreau de la colère. On est face à un crime légal sans coupable. Un crime parfait en somme. Ce qui est d’autant plus dur à avaler.
Pourtant Barack Obama avait les moyens de réformer le système en 2009. Les banques étaient en situation délicate, mais il n’a rien fait. Pourquoi à votre avis ?
Il y avait deux écoles qui s’affrontaient au sein de son administration. Ceux qui pensaient qu’il fallait saisir cette occasion pour demander des gages aux grandes banques. Et ceux qui pensaient que les États-Unis avaient besoin de la finance pour juguler cette crise. Il a choisi la deuxième solution en ménageant Wall Street. En même temps ce n’est pas si étonnant que cela. En 2008, l’un de ses principaux contributeurs de campagne était Goldman Sachs. On ne pouvait donc pas attendre de la part d’Obama une attitude révolutionnaire vis-à-vis de la finance. Il avait pourtant la majorité nécessaire pour le faire. Quand les 13 banquiers arrivent à Washington en 2009, ils s’attendent à aller à l’abattoir. Mais encore une fois, rien.
Pour terminer, êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la prise de conscience des origines de la crise et de son après ?
Je suis un optimiste. Je pense que les gens se rendent compte que ça a été du grand n’importe quoi. Le réveil est douloureux. Après ça fonctionne par cycle. On arrive à la fin d’un cycle et on ne sait pas quand commence l’autre. Ceux qui payent ne sont pas forcément ceux qui en ont bénéficié. Contrairement à 2008, où les gens ont pris ça dans la gueule sans rien dire. Aujourd’hui il y a une réaction, certains sont en colère, d’autres veulent changer de système. Je trouve que les termes du débat sont déjà beaucoup plus riches qu’en 2008. On comprend un peu mieux le passé et on s’éloigne doucement de la pensée unique de l’apologie du marché.